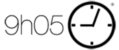L’étude des proto-langues, au cœur de la paléolinguistique, et l’analyse sémiotique de l’art pariétal semblent, au premier abord, appartenir à des domaines distincts. L’une reconstruit des systèmes de communication orale disparus, l’autre interprète les formes visuelles laissées sur les parois des grottes. Pourtant, toutes deux partagent un même objectif : comprendre comment les premières sociétés humaines donnaient sens au monde et transmettaient ce sens à travers des signes.
Proto-langues : voix perdues, reconstructions hypothétiques
Les proto-langues, comme le proto-indo-européen ou le proto-ouralique, sont reconstituées grâce à la méthode comparative. Elles témoignent d’une organisation cognitive sophistiquée : catégorisation du réel, élaboration de systèmes grammaticaux, mise en place de lexiques partagés. Mais elles ne sont jamais directement accessibles : aucun document écrit ne conserve leur trace. Elles ne subsistent que par les transformations régulières observées dans les langues filles.
L’art pariétal : une autre forme de langage ?
De la même manière, l’art pariétal préhistorique — fresques de Lascaux, peintures d’Altamira, gravures de Chauvet — ne nous transmet pas un “discours” explicite. Ce sont des signes visuels dont la signification doit être interprétée. La sémiotique s’y intéresse comme à un système de communication : formes animales, symboles géométriques, jeux de couleurs et de reliefs ne sont pas de simples ornements, mais porteurs de valeurs sociales, spirituelles ou rituelles.
Un parallèle sémiotique
On peut envisager la paléolinguistique et la sémiotique de l’art pariétal comme deux versants d’une même quête. Dans les deux cas :
-
Absence de données directes : pas d’enregistrements pour les proto-langues, pas de légende explicative pour les peintures.
-
Travail de reconstruction : par comparaison linguistique d’un côté, par analogie anthropologique et symbolique de l’autre.
-
Hypothèses interprétatives : la reconstruction d’un mot proto-indo-européen ou l’interprétation d’une figure animale dans une grotte reposent sur des faisceaux d’indices, mais jamais sur une certitude absolue.
Langage oral et langage visuel : complémentarité
Il est possible que l’art pariétal ait joué un rôle complémentaire au langage oral. Si les proto-langues véhiculaient le savoir quotidien et les récits, les images pouvaient servir à fixer des représentations collectives : mythes, rituels de chasse, visions chamaniques. On peut alors envisager les parois ornées comme une forme de “proto-écriture” symbolique, parallèle à l’évolution des proto-langues.
De plus, la sémiotique suggère que l’art pariétal n’était pas seulement représentationnel mais performatif : peindre un bison pouvait être une manière de convoquer sa présence dans le rituel. De la même façon, prononcer certains mots dans une proto-langue pouvait avoir une valeur incantatoire ou rituelle.
Vers une sémiologie globale de la préhistoire
Associer paléolinguistique et sémiotique de l’art pariétal, c’est proposer une sémiologie élargie de la préhistoire. On ne s’intéresse plus seulement à ce que les hommes disaient ou peignaient, mais à la manière dont ils organisaient les signes pour construire du sens. Ces systèmes parallèles — oral et visuel — révèlent la créativité symbolique des premiers Homo sapiens.
Ainsi, l’étude des proto-langues et de l’art pariétal converge vers une même intuition : la communication humaine, qu’elle soit phonique ou graphique, est inséparable de la faculté de symboliser. Les langues disparues et les fresques rupestres sont deux témoins différents mais complémentaires d’un même besoin ancestral : dire le monde, le représenter, et le partager.